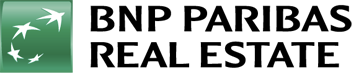Le temps d’une mondialisation fluide et sans frontières semble révolu. Sous l’effet des tensions géopolitiques et des incertitudes économiques, les chaînes d’approvisionnement internationales se fragmentent. Les États cherchent à reprendre le contrôle de leur production, à relocaliser certaines filières stratégiques, et à redéfinir leurs priorités industrielles.
Dans ce contexte de reterritorialisation, quels impacts pour l’immobilier d’entreprise ? Et comment les acteurs peuvent-ils s’adapter à ces nouvelles dynamiques ?
Une actualité impactant le modèle de mondialisation
La création de l’OMC le 1er janvier 1995 a marqué un tournant majeur dans l’histoire du commerce international. L’objectif : favoriser la liberté des échanges et établir des règles communes pour encadrer le commerce mondial. Trente ans plus tard, l’institution apparaît affaiblie, et le modèle de mondialisation qu’elle incarne semble en perte de vitesse.
Alors même que le monde n’a jamais été aussi interconnecté, les crises successives ont fait émerger un mouvement inverse : celui d’une démondialisation partielle.
En 2018, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ravive les logiques protectionnistes. Sous l’administration Trump, des mesures sont prises pour limiter les importations et défendre l’industrie nationale.
Puis vient la pandémie de Covid-19, révélant brutalement la dépendance des pays européens — notamment la France — à des chaînes d’approvisionnement mondialisées. Un article du Figaro datant de mai 2020 rappelait que jusqu’à un tiers de la production de certains biens de première nécessité avait été externalisé*. Face à cette vulnérabilité, les Etats cherchent à rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique. Cette souveraineté passe par une relocalisation partielle de la production, au plus près des bassins de consommation.
La guerre en Ukraine agit, elle, comme catalyseur de cette fragmentation géoéconomique. En provoquant une flambée des prix de l’énergie, elle fragilise les filières industrielles les plus énergivores : acier, verre, chimie… autant de secteurs déjà sous tension.
Enfin, plus récemment, le 9 juillet dernier, la Maison Blanche ravivait les tensions commerciales avec l’annonce de droits de douane de 30 % visant notamment l’Union européenne. Une mesure inédite depuis les années 1930. Le 27 juillet 2025, la présidente de la Commission européenne et le président des Etats-Unis sont toutefois parvenus à un accord de principe pour appliquer un droit de douane unique de 15 % sur la plupart des produits vendu aux USA.
Vers une stratégie de recentralisation européenne, voire de régionalisation
La crise du paracétamol, en 2020, a marqué les esprits comme le symbole d’un abandon progressif de la souveraineté sanitaire française et a amené à une prise de conscience en vue de la relocalisation des biens en France et qui ne se limite pas au secteur pharmaceutique. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de réindustrialisation ciblée. Le groupe Airbus, par exemple, a relocalisé la fabrication de pales en Île-de-France. De son côté, Safran, acteur majeur de l’aéronautique et de la défense, a lancé au début du mois de juillet le chantier d’une nouvelle usine sur le site de La Janais, près de Rennes. Ce site industriel stratégique entrera en activité en 2027, avec une montée en puissance progressive jusqu’à l’horizon 2030-2032. Ces exemples devraient se généraliser.
Quels seront les conséquences sur la production et sur la distribution ? Quelles seront également les conséquences sur le segment du bureau ?
Quels impacts sur l’immobilier ?
Face à ces mutations, l’immobilier d’entreprise doit repenser ses implantations, ses modalités d’exploitation et, plus globalement, sa place dans une nouvelle géographie productive en pleine reconfiguration.
- Pour la partie industrielle et logistique :
La relocalisation se heurte à certains obstacles : le manque de foncier disponible, ou encore la pénurie de main-d’œuvre qualifiée (dans des zones loin des agglomérations). Ces contraintes poussent les acteurs du secteur à explorer des alternatives innovantes. Des modèles émergents voient ainsi le jour, comme les entrepôts à étages ou les micro-hubs logistiques, mieux adaptés aux exigences du commerce de proximité et à la logistique du dernier kilomètre.
La technologie joue également un rôle clé : l’automatisation des entrepôts progresse à grande vitesse, portée par l’essor de la robotique et de l’intelligence artificielle. Ces outils permettent non seulement d’optimiser les flux logistiques, mais aussi de pallier le manque de personnel tout en augmentant la productivité.
Parallèlement, la transition écologique imprime sa marque sur l’immobilier logistique. Les nouvelles constructions intègrent de plus en plus des matériaux durables et des infrastructures à faible impact environnemental, comme les panneaux solaires, les systèmes de récupération d’eau ou encore les bornes de recharge pour véhicules électriques.
Pour ce secteur de l’activité, il est certain en France, que nous avons atteint un point bas en termes d’industries présentes sur le territoire français. Un redéploiement de l’industrie est donc à prévoir (certainement hautement automatisé). Le développement des datas centers devrait accentuer ce phénomène de développement des locaux à usage d’activité. Ce nouveau paradigme sera positif pour ce secteur. La logistique mécaniquement devrait en bénéficier aussi par ricochet.
- Pour la partie des bureaux :
Le marché immobilier de bureau est actuellement en cycle bas (tant dans ses valeurs que dans ses volumes de transactions). La possible remontée des taux de l’OAT est une menace pour ce segment (comme pour les autres) en termes de valeurs vénales, compte tenu de la dérive de la dette française. Le « spread » entre OAT et le taux prime bureau français paraît faible.
Une autre menace est l’obsolescence géographique de certaines zones en périphérie des grandes villes où les taux de vacances sont importants. Certains immeubles de bureaux devront être reconvertis.
En revanche, cette réindustrialisation et cette nouvelle organisation par grand secteur régional (Europe, Amérique, Asie/Pacifique) devraient être favorables à la demande placée pour les bureaux.
En effet, la réindustrialisation amènera mécaniquement des demandes de bureau et la régionalisation de la production développera des directions régionales (l’Europe pour la France) où cette dernière sera donc en concurrence avec les autres pays européens (ce qui est déjà le cas actuellement).
Par conséquent, en dépit des problèmes actuels (instabilité gouvernementale, dette), ce nouveau paradigme devrait être positif, en termes de demande placée pour le segment des bureaux, à long terme (cette analyse ne prend pas en compte les évolutions de l’euro/dollar, les conséquences sur l’économie des barrières douanières ou celles des conflits armés actuels ou futurs).
* Source : Le Figaro, 20/05/2020 – La majorité des entreprises prévoient des difficultés d'approvisionnement